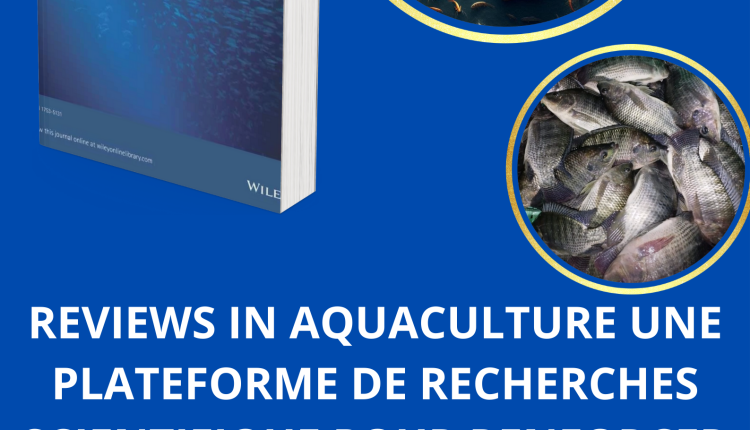REVIEWS IN AQUACULTURE UNE PLATEFORME DE RECHERCHES POUR RENFORCER L’AQUACULTURE AFRICAINE
L’aquaculture en Afrique présente un potentiel de croissance important, mais sa contribution à la production mondiale reste minime. Si des pays comme l’Égypte, le Nigeria et l’Ouganda ont réalisé des progrès notables, de nombreuses nations africaines sont encore confrontées à des défis tels que la disponibilité des aliments pour animaux, la gestion des maladies et l’accès au marché. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel d’adopter une approche axée sur la recherche, en se concentrant sur les pratiques durables et en intégrant l’aquaculture dans les stratégies de développement nationales. Pour faire progresser l’aquaculture en Afrique, il faut s’attaquer aux principales priorités de la recherche, notamment les améliorations génétiques et les stratégies de gestion des maladies. La croissance immédiate dépend de l’accès aux ressources, de l’investissement et d’une main-d’œuvre qualifiée, ce qui souligne l’importance de l’éducation et de l’accès au marché. Les interventions politiques devraient créer un environnement favorable à la croissance de l’aquaculture, en se concentrant sur les infrastructures, les incitations financières et la participation du secteur privé. Les études scientifiques peuvent guider les orientations futures en synthétisant les recherches, en identifiant les lacunes et en proposant des recommandations fondées sur des données probantes. En favorisant l’échange de connaissances et en soutenant les pratiques durables, l’aquaculture africaine peut s’intégrer dans les avancées mondiales tout en relevant les défis qui lui sont propres.
L’aquaculture en Afrique recèle un potentiel considérable, mais sa contribution à la production mondiale reste limitée. Si des progrès significatifs ont été réalisés dans des pays comme l’Égypte, le Nigéria et l’Ouganda, de nombreux pays africains continuent de se heurter à des défis tels que la disponibilité des aliments, la gestion des maladies, l’accès au marché et l’investissement. Pour surmonter ces obstacles, il est nécessaire d’adopter une approche axée sur la recherche qui favorise l’innovation, soutient les pratiques durables et intègre l’aquaculture dans les stratégies nationales de développement.
Malgré sa part mondiale relativement faible, l’aquaculture africaine a été multipliée par près de 20 depuis les années 1990 (Adeke et al., 2021). Cependant, cette croissance reste inégale, l’Égypte représentant à elle seule plus de 70 % de la production du continent. D’autres pays sont confrontés à des contraintes liées à la qualité des aliments, à la disponibilité des semences et à la faiblesse des liens avec le marché . Le développement d’aliments durables, tel qu’examiné par Iheanacho et al. (2025) est particulièrement crucial, car la dépendance actuelle à la farine de poisson exerce une pression sur les stocks sauvages et a un impact négatif sur les coûts de formulation. Il est également essentiel de trouver un équilibre entre les considérations économiques et environnementales. L’aquaculture a un impact positif sur la croissance du PIB dans de nombreux pays africains, mais elle présente également des inconvénients environnementaux. Si l’aquaculture peut initialement contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en compensant la pression sur les stocks de poissons sauvages, son expansion à long terme peut augmenter son empreinte carbone ou introduire d’autres risques environnementaux si elle n’est pas gérée correctement. Cela souligne la nécessité de politiques qui soutiennent les méthodes d’élevage à faible impact, optimisent l’utilisation des ressources et améliorent les stratégies de gestion des déchets pour assurer une croissance durable. La recherche et l’innovation technologique sont essentielles pour relever les défis du secteur. Les pays qui ont investi dans la recherche aquacole, comme l’Égypte et le Nigéria, ont enregistré les gains les plus significatifs.
Le progrès de l’aquaculture africaine nécessite de se concentrer fortement sur les priorités de recherche clés. Les améliorations génétiques, notamment par la sélection génétique, peuvent améliorer les taux de croissance, la résistance aux maladies et l’efficacité alimentaire des espèces largement élevées comme le tilapia et le poisson-chat africain. Il est tout aussi important de développer des stratégies de gestion des maladies qui minimisent le recours aux antibiotiques, garantissent des stocks de poissons plus sains et réduisent les pertes de production. Si le changement climatique représente un défi majeur à long terme en modifiant la température de l’eau, les niveaux d’oxygène et la santé globale des poissons, la recherche sur la résilience climatique est essentielle au développement de techniques d’élevage adaptatives garantissant une production durable. Cependant, à court terme, la croissance de l’aquaculture en Afrique dépend plus directement de l’accès aux ressources naturelles, des investissements et d’une main-d’œuvre qualifiée. Sans un soutien financier suffisant et une main-d’œuvre bien formée, même les technologies les plus résilientes au climat ne peuvent être mises en œuvre efficacement. Par conséquent, parallèlement à l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de privilégier l’éducation et l’investissement pour bâtir une industrie aquacole viable et compétitive sur le continent. Le renforcement de l’accès aux marchés et des chaînes de valeur sera également essentiel, avec des efforts nécessaires pour améliorer les réseaux de distribution, développer les installations d’entreposage frigorifique et affiner les politiques commerciales afin de mieux connecter les petits exploitants à des marchés plus vastes. Enfin, il faut privilégier les solutions alimentaires durables, garantissant la disponibilité d’options alimentaires respectueuses de l’environnement et économiquement viables, adaptées aux espèces et aux systèmes de production locaux.
Les interventions politiques doivent favoriser un environnement propice à la croissance de l’aquaculture en soutenant le développement des infrastructures, en offrant des incitations financières pour une agriculture durable et en encourageant la participation du secteur privé. De plus, des investissements importants dans l’éducation sont essentiels, allant de la formation professionnelle aux programmes d’enseignement supérieur qui forment les futurs dirigeants et professionnels du secteur.
Dans ce contexte, les articles de synthèse scientifiques peuvent jouer un rôle crucial pour façonner l’avenir de l’aquaculture africaine en synthétisant des recherches fragmentées, en identifiant les lacunes dans les connaissances et en orientant les décisions politiques. Les revues systématiques peuvent mettre en évidence les meilleures pratiques, comparer les stratégies aquacoles mondiales aux conditions spécifiques de l’Afrique et proposer des recommandations fondées sur des données probantes. De plus, les méta-analyses peuvent fournir des informations sur les tendances en matière de taux de croissance des poissons, d’efficacité alimentaire et de résistance aux maladies dans différentes conditions d’élevage.
Le rôle de Reviews in Aquaculture est plus important que jamais, et nous invitons des experts possédant une connaissance approfondie de l’aquaculture africaine à contribuer à des analyses approfondies sur les innovations en matière d’alimentation durable, la résilience climatique et les modèles économiques pour soutenir la croissance du secteur. En synthétisant les recherches actuelles et les connaissances pratiques, en mettant en évidence les lacunes existantes, en suggérant des orientations de recherche futures et en fournissant des avis et recommandations scientifiques pertinents, ces contributions contribueront à éclairer les politiques, à orienter les investissements et à promouvoir des pratiques durables. La revue constitue une plateforme essentielle d’échange de connaissances, fournissant aux parties prenantes les bases scientifiques nécessaires pour promouvoir une aquaculture résiliente, écologiquement durable, économiquement viable et socialement acceptée dans le monde entier. Elle intègre les réalités diverses du secteur, couvrant un éventail toujours croissant d’espèces d’élevage, de taxons, d’environnements, des systèmes d’eau douce aux systèmes marins hauturiers, des régions polaires aux régions tropicales, et de méthodes d’élevage, des systèmes extensifs en étangs aux systèmes d’aquaculture en recirculation très avancés, basés sur des technologies d’aquaculture de précision. Dans ce vaste cadre, le développement de l’aquaculture africaine doit également être une priorité, en veillant à ce que la recherche et l’innovation soutiennent sa croissance et son intégration aux avancées mondiales de l’aquaculture.
Source : Giovanni M. Turchini, Nie Pin. 2025. Strengthening African Aquaculture. Volume17, Issue2. March 2025. e70018. https://doi.org/10.1111/raq.70018.